Vers une Stratégie à l’ère du temps : Comment la FAO Combat la Pauvreté Alimentaire au Cameroun !

Tchatchoua Toko Gérald, Assistant du Représentant de la FAO Cameroun
La région de l’Est Cameroun, tout comme les régions de l’Extrême-Nord, l’Adamaoua, Nord-Ouest et Sud-Ouest, fait face à des défis importants en matière de sécurité alimentaire et de résilience climatique, ceci dû à un contexte marqué par une faible croissance économique associées à une pauvreté grandissante.
Tchatchoua Toko Gérald, Assistant du Représentant de la FAO Cameroun (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) nous fait découvrir les données et les initiatives de cette organisation pour assurer la sécurité alimentaire.
Quelles sont les actions que la FAO a menées tout au long de l’année dans ces parties du pays ?
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, la FAO a contribué à la collecte et l’analyse des données par le biais des outils Cadre Harmonisé et DIEM (Centre de données de la FAO sur les situations d’urgence). Ainsi, le niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans ces régions a été apprécié pour la prise de décision.
Comme réponse, la mise en œuvre du PULCCA (projet d’urgence de lutte contre la crise alimentaire) par la FAO dans la région de l’Est contribue à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en phase sous pression et phase crise alimentaire à travers les productions : maraichère (450 ménages), banane plantain (1500 ménages), igname (1000 ménages), manioc (1000 ménages), poule locale et petits ruminants (200 par spéculation), poulet de chair, pondeuse, porc, miel et lait (100 par spéculation).
Dans le cadre des productions végétales, grâce à 750 000 rejets de bananier plantain, 650 hectares de terre ont été emblavés pour une production escomptée de 13 750 tonnes de banane plantain. Parallèlement, la distribution de 2 500 000 boutures de manioc a permis de valoriser 250 hectares de terre, avec une production attendue de 6 250 tonnes de manioc. Relativement à la culture d’igname, 500 000 semenceaux couvrant ainsi 50 hectares pour une production attendue d’environ 2 250 tonnes d’igname. Enfin, les cultures maraîchères, incluant la pastèque, la tomate et la morelle noire pour une superficie de 117 hectares et une récolte estimée à 2 980 tonnes.
Dans le domaine des productions animales, les intrants et matériels de productions acquis et distribués permettront également d’améliorer la disponibilité en protéines animales. Ainsi, c’est 5 000 poussins chair pour une production attendue de 10 tonnes de viande.
De même, 2 400 poules locales pour une production d’environ 18 000 œufs au terme de l’année. Concernant la production porcine, 500 porcelets permettront de produire 50 tonnes de viande. Aussi, 1 000 petits ruminants produiront environ 25 tonnes de viande. Enfin, 500 ruches kenyanes pour une production estimée à 12, 5 tonnes miel.
Depuis 2003, les États africains se sont engagés à consacrer chaque année 10 % de leur budget au financement du secteur agricole, afin de stimuler une croissance de 6% et de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la création d’emplois et à l’alimentation adéquate de leurs populations. A ce jour, quel est l’état des lieux ?
Malgré les difficultés liées notamment à la collecte des données, une évaluation réalisée en 2022 avec l’appui de la FAO a permis d’évaluer les dépenses du secteur rural à environ 328,5 milliards en 2022 correspondant à un ratio de Maputo de 5,75%.
En vue de permettre à ce que ces dépenses aient un impact réel sur la croissance du secteur, un effort particulier devra être mené dans le sens de l’amélioration de sa qualité.
A travers les actions que mènent la FAO au Cameroun, y’a-t-il une meilleure stratégie à adopter pour réduire la pauvreté alimentaire au pays ?
Réduire la pauvreté alimentaire est un défi complexe qui nécessite l’adoption d’une approche multifacette. Concernant les actions menées par la FAO, il est nécessaire de combiner ces différentes stratégies et de les passer à échelle, ce qui permettra de réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à long terme.
Il s’agit notamment de l’amélioration de l’accès aux ressources, l’accompagnement des producteurs pour l’adoption des pratiques agricoles durables et l’amélioration de leur productivité, l’utilisation des technologies innovantes de production, la mise en œuvre des programmes spécifiques d’appui pour les populations les plus vulnérables, le soutien aux initiatives locales, etc.
Le renforcement des capacités des producteurs locaux pour des régimes alimentaires sains et durables permettra-t-il de répondre à la demande alimentaire croissante ? Contribuera-t-il grandement à protéger la sous-région contre les futurs chocs du marché ?
Renforcer les capacités des producteurs locaux peut jouer un rôle crucial dans la réponse à la demande alimentaire croissante, à travers l’augmentation de la production locale ; la disponibilité d’aliments frais sains et nutritifs (réduction de la dépendance aux produits transformés) ; le soutien à l’économie locale ; la résilience (les producteurs locaux formés sont plus résilients face aux chocs climatiques et économiques) ; la pratique de l’agriculture durable (protection des ressources naturelles et à la préservation de l’environnement pour les générations futures) ; la réduction locale des pertes post-récoltes et des déchets alimentaires en minimisant le transport et en améliorant les techniques de stockage ; Renforcer les capacités des producteurs locaux contribuera de manière substantielle à protéger la sous-région contre les futurs chocs du marché.
Cette année, la Journée mondiale de l’alimentation a eu pour thème « Le droit aux aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs ». Ce thème vient opportunément nous rappeler le droit de chaque personne à une alimentation adéquate. Mais comment traduire en actes ce droit ? Pourquoi est-il si important de veiller non seulement à une alimentation suffisante, mais aussi à la diversité des régimes alimentaires ?
Pour traduire le droit à une alimentation adéquate en actes au Cameroun, il faudrait penser à soutenir les agriculteurs locaux par des subventions, des formations et l’accès à des technologies modernes pour augmenter la production et améliorer la sécurité alimentaire, développer des réseaux de transport et des infrastructures de stockage pour réduire les pertes post-récolte et assurer une distribution plus efficace des produits alimentaires, informer les populations sur la nutrition et les pratiques agricoles durables pour contribuer à améliorer la qualité de l’alimentation et réduire la malnutrition, mettre en place des programmes sociaux pour soutenir les ménages à faible revenu ou vulnérables, pour accéder aux aliments nutritifs, établir des normes de qualité et de sécurité sanitaire protégeant les consommateurs et s’assurer que les aliments disponibles sont nutritifs et propres à la consommation humaine ; promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, etc.
La diversité des régimes alimentaires est importante, car sachant qu’aucun aliment ne contient tous les nutriments nécessaires à notre corps, elle permet d’accéder à une gamme complète de vitamines, minéraux, protéines, fibres et autres éléments essentiels à la santé ; de prévenir les maladies chroniques comme le Diabète, les maladies cardio-vasculaires et certains cancers, de renforcer le système immunitaire permettant ainsi au corps de résister aux infections, de contribuer à l’amélioration de l’humeur et des niveaux d’énergie, contribuant ainsi au bien-être général.
La diversité alimentaire permet aussi de préserver et valoriser les différentes cultures et traditions culinaires et réduire la dépendance à une seule culture ou type de nourriture, ce qui est crucial en cas de crises agricoles ou de perturbations climatiques.
En termes de statistique officielle, combien de personnes dans le monde et en particulier au Cameroun souffrent de la faim en raison des catastrophes d’origine naturelle ou anthropique, parmi lesquelles on retrouve les conflits, les dérèglements climatiques répétés, les inégalités et les récessions économique ?
Selon le dernier rapport sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) publié en juillet 2024 par cinq agences des Nations Unies, entre 713 millions et 757 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, soit 1 personne sur 11 dans le monde et 1 personne sur 5 en Afrique.
Au Cameroun, le rapport de l’analyse Cadre Harmonisé d’octobre 2024 indique qu’entre octobre à décembre derniers, 10,82% de personnes étaient en insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue sur l’ensemble du territoire national, soit 3,080,145 personnes parmi lesquelles 265,314 personnes en urgence et 2,814,832 personnes en crise.
Les principaux facteurs déterminants enregistrés pendant cette période sont les inondations dans le région de l’Extrême-Nord avec une sévérité plus importante dans les départements du Logone & Chari et du Mayo Danay ; les poches de sècheresse accrue dans les départements du Mayo Louti et de la Bénoué ; la persistance de la crise socio politique dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest ; les enlèvements avec demande de rançon dans le Mayo Rey et l’Adamaoua, les incursions sporadique de Boko Haram dans les départements du Mayo Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone et Chari ; les attaques des chenilles sur les céréales dues aux poches de sècheresse dans la Bénoué, le Mayo Louti ; et la hausse des prix généralisée des denrées alimentaires tributaire de l’augmentation du prix du carburant.

Quelles seront les actions majeures de la FAO au Cameroun en 2025 ?
Les interventions de la FAO au Cameroun sont guidées par le Cadre de programmation pays FAO/Cameroun pour 2022-2026, en cohérence avec les stratégies nationales et l’UNSDCF. La vision de la FAO repose sur les principes des « four better » : meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleure vie. En 2025, plusieurs axes d’intervention seront mis en avant :
Meilleure production :
- Soutien au développement de chaînes de valeur à fort potentiel d’exportation (végétales, forestières, animales et halieutiques).
- Appui aux coopératives et start-ups dirigées par des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables pour transformer l’économie.
Meilleure nutrition :
- Assistance aux populations vulnérables, notamment les femmes enceintes et allaitantes, pour améliorer l’alimentation et renforcer le système national de sécurité alimentaire, avec un accent sur les données désagrégées par sexe.
- Plaidoyer auprès du parlement via l’alliance parlementaire pour prioriser les systèmes alimentaires et le financement des interventions nutritionnelles.
Meilleure vie :
- Soutien aux acteurs de la société civile, y compris les jeunes et les femmes, pour une participation inclusive aux processus décisionnels à tous les niveaux et l’anticipation et de réponse aux différents chocs
Meilleur environnement :
- Appui à l’amélioration du cadre institutionnel pour faciliter l’accès au financement climatique et la gestion des données environnementales;
- Collaboration avec les acteurs institutionnels pour concevoir des actions intégrées visant à améliorer l’état de l’environnement et à lutter contre les changements climatiques.
Propos recueillis par Albert BOMBA








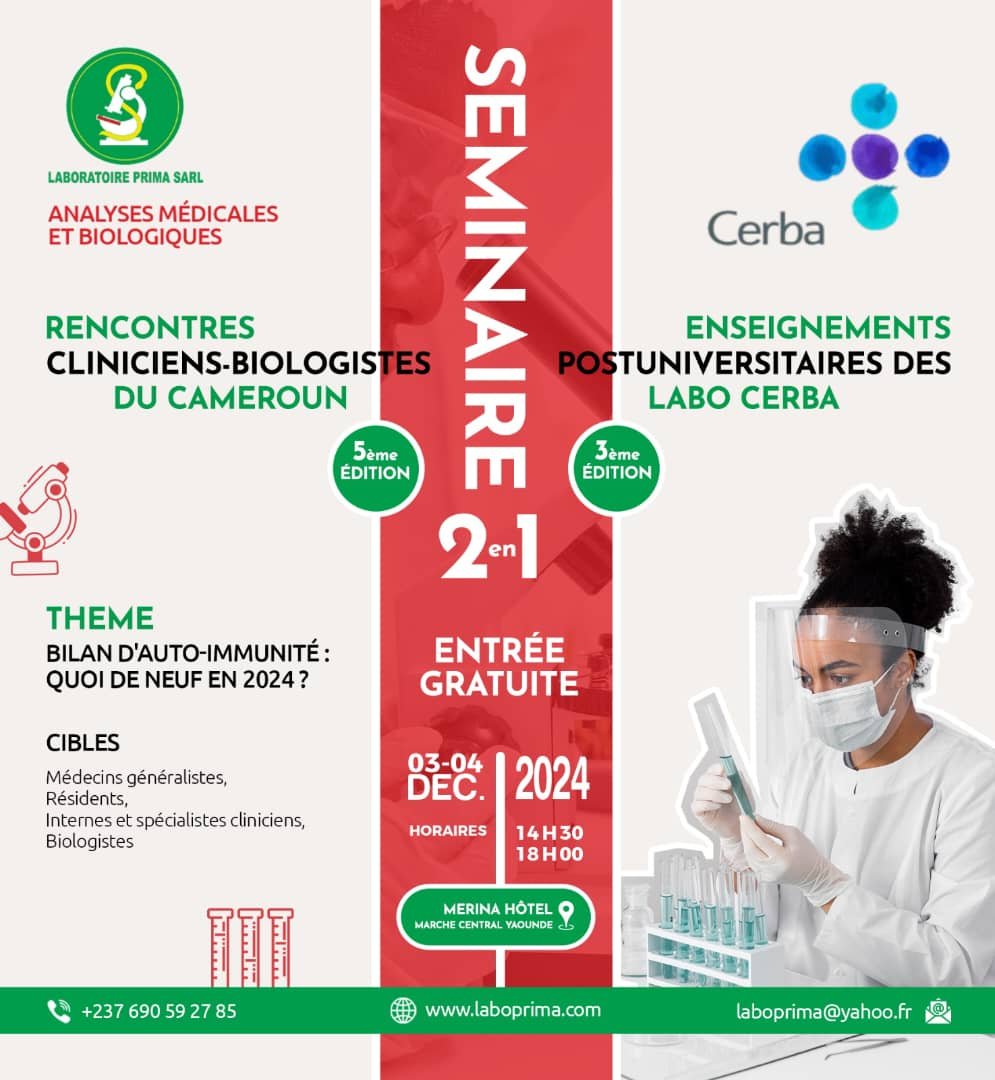











 Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.
Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.