Extrême-Nord : Le Consortium FAO/UNFPA évalue un projet de 3,30 millions d’euros

La région septentrionale du Cameroun fait face à des défis à la fois climatiques, humanitaires et sécuritaires. D’ailleurs les données de l’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC), révèlent un risque de sécheresse et d’inondations qui reste perceptible.
Comme réponse, le projet « Réduire les besoins humanitaires dans l’Extrême-Nord du Cameroun en renforçant la préparation et l’anticipation des acteurs multi-niveaux face aux chocs, via une approche intégrée sensible aux conflits, au climat et à la protection », entend prévenir ou limiter les effets des catastrophes avant qu’elles ne surviennent.
Financé à hauteur de 2,95 millions d’euros par le donateur DG ECHO, mis en œuvre par la FAO, UNFPA et partenaires. Le projet lancé en juillet 2024 combine un paquet d’activités axé sur la préparation, les actions d’anticipation et de gestion des risques de catastrophe. À son terme en juin 2026, c’est 440 685 personnes (223 031 femmes et 217 654 hommes) qui devraient être touchées dans les 12 arrondissements sélectionnés et répartis dans les départements du Logone et Chari ; Mayo-Tsanaga ; Mayo-Sava et Mayo-Danay. Objectif recherché, réduire la vulnérabilité aux chocs récurrents des communautés rurales en particulier les femmes et les filles, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap.
Mise en place des Commissions Communales de Préparation et de Réponse aux crises ( CCPR)
À 45 km de Kousseri, la commission de Logone-Birni est à pied d’œuvre. Dans une collaboration renforcée entre la sous-préfecture, la commune et les populations, plusieurs actions ont déjà vu le jour et d’autres sont en cours. À la tête, le sous-préfet de cette unité administrative de 3607 km2, Tchombai Ibrahi coordonne, apprécie et salue ce qui est déjà fait. « Nous attendons encore beaucoup d’actions dans le cadre de la gestion des risques, mais nous saluons déjà l’activité mise en œuvre par la FAO, UNFPA et d’autres partenaires. Chaque acteur cité, continue de contribuer dans son domaine via les formations, sensibilisations et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) ; la distribution des sacs vides pour confectionner les diguettes des villages, la distribution des semences améliorées adaptées aux variations climatique et de matériels agricoles pour accompagner les populations ».
Quelques pas plus loin, Bello Hayatou, Chef de cellule logistique CCPR et représentant du maire évoque les actions anticipatoires entreprises avec l’aide du consortium FAO, UNFPA et Cie. « Grâce à l’atelier de renforcement des capacités, des séances de sensibilisation ont suivi, des plaidoyers également ce qui a conduit à la construction d’une digue dans le village de Maham par la commune. Sur la base d’une identification minutieuse de la CCPR, la FAO a fait bénéficier aux populations les plus vulnérables, des cash transfert. Le stock de contingence a d’ailleurs doublé avec la mise à disposition de sacs vides, semences améliorées, tourteaux de coton, blocs à lécher, brouettes et bien d’autres choses. Au niveau du conseil municipal, l’enveloppe gestion des calamités est passée de 3 à plus de 15 millions de Fcfa sur la base du plaidoyer mené par le maire ».
Diguettes pour contrer la montée des eaux, semences pour soutenir les communautés rurales
À Maham, une digue de 900 mètres se dresse majestueusement, la localité a fortement subi les inondations de 2024. Outre la distribution des kits agricoles, des semences et autres packages. Sur les 300 séances de sensibilisation – terrain recensées depuis le début du projet, Maham a fait l’objet d’un arrêt majeur à chaque fois. Ici, le comité communautaire ( CC) accentue la sensibilisation par une communication de proximité, laquelle se joint à celles qui défilent en boucle sur les ondes des radios communautaires.
À quelques 3 à 5 Km de Kousseri, les populations de Hadjarangoubou mènent des actions anticipatoires palpables. Les sacs vides reçus et chargés par la suite vont contribuer au renforcement de la diguette qui s’étale sur près de 2 kilomètres à la ronde. Au sein de la communauté, hommes et femmes ont reçu comme partout ailleurs un accompagnement ( des semences améliorées de maïs, niébé, morelle noire, sorgho sp, gombo et poivron) ; des machettes; des houes, des pulvérisateurs…Etc.
Sous le soleil ardent de Gambarou-Bornou, le champ de Modou Adji Mahamat est à maturité. Heureux bénéficiaire de 5 kg de sorgho zouaye parmi les 200 personnes ciblées, sa récolte devrait tourner autour de 4 tonnes pour sa parcelle évaluée à 2500 m². Grâce à cette semence améliorée, la production de Modou a pratiquement triplé, et il comme produire du sorgho sur toute l’année. Cette variété présente un atout : un cycle de production estimé à 2 mois seulement.
Miser sur l’expérience de terrain pour anticiper
À bord de sa moto, Abba Icho, technicien des industries animales et membre de la Commission Communale de Préparation et de Réponse aux Crises, crée la différence. De Logone-Birni à Maham en passant par Gambarou-Bornou ou Hadjarangoubou, sa présence est effective dans tout l’arrondissement. De manière non exhaustive, il livre point par point les actions anticipatoires déjà menées, à savoir : La formation des membres du CCPR et des comités communautaires ; la cartographie des zones à fort risque d’inondations; le ciblage des zones de relocalisation d’urgence; des exercices de simulation pour tester et renforcer la préparation des communautés exposées aux inondations fluviales; le ciblage des bénéficiaires du cash anticipatoire sur la base d’une méthodologie bien définie … Etc.
Si au lendemain des inondations, la riposte avait été engagée via des réunions d’évaluation suivi au fil du temps par plusieurs campagnes de distribution. « Comme nous avions fait le choix des villages vulnérables et la distribution du cash… tout le monde était très satisfait … Nous souhaitons que le projet ECHO nous accompagne encore un peu plus pour qu’à l’avenir, le CCPR soit une branche de gestion de catastrophe de la commune avec des missions bien budgétisées pour mieux asseoir la décentralisation. Ici, on demande encore du renforcement de capacités », soutient Abba Icho.
Un projet aux effets positivement visibles
En matière de catastrophe naturelle, l’anticipation et la prévention jouent un rôle déterminant. À en croire Léonard Djingui Souga, Chef projet ECHO et spécialiste national DP/AA à la FAO, « Ce projet génère des effets en plusieurs dimensions clés, notamment la réduction des pertes humaines et matérielles. Ici et grâce aux actions anticipatoires, il devient possible de prévenir ou de limiter les effets des catastrophes avant qu’elles ne surviennent. Cette approche permet de réduire de manière significative les dégâts matériels et les pertes humaines, offrant ainsi une protection accrue aux communautés ».
En termes de renforcement de la résilience communautaire : Le projet permet aux communautés de mieux se préparer, d’être mieux informées et de disposer des outils nécessaires pour faire face aux chocs. Cela renforce leur capacité à s’adapter aux crises futures, en assurant une résilience à long terme et une meilleure gestion des impacts.
Au niveau de la protection des populations vulnérables : En intégrant des dimensions essentielles telles que le genre VBG (violences basées sur le genre) SSR (Santé sexuelle reproductive) ; la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, le projet garantit une approche équitable. Cette démarche assure une réponse ciblée et adaptée aux besoins spécifiques de ces groupes, souvent les plus exposés.
Quant à la réduction des coûts d’intervention humanitaire : Les Actions Anticipatoires sont généralement moins coûteuses que l’intervention après une crise (Réponse). En anticipant les risques, le projet minimise les besoins urgents d’interventions humanitaires, optimisant ainsi l’utilisation des ressources disponibles et réduisant les coûts à long terme.
Enfin, au volet de l’amélioration de la coordination et de la gouvernance locale : Le projet favorise l’implication des acteurs locaux, ce qui renforce leurs capacités institutionnelles et soutient une gouvernance participative. Cette approche permet d’assurer une gestion plus cohérente, inclusive et efficace des risques.
Martial Obiona








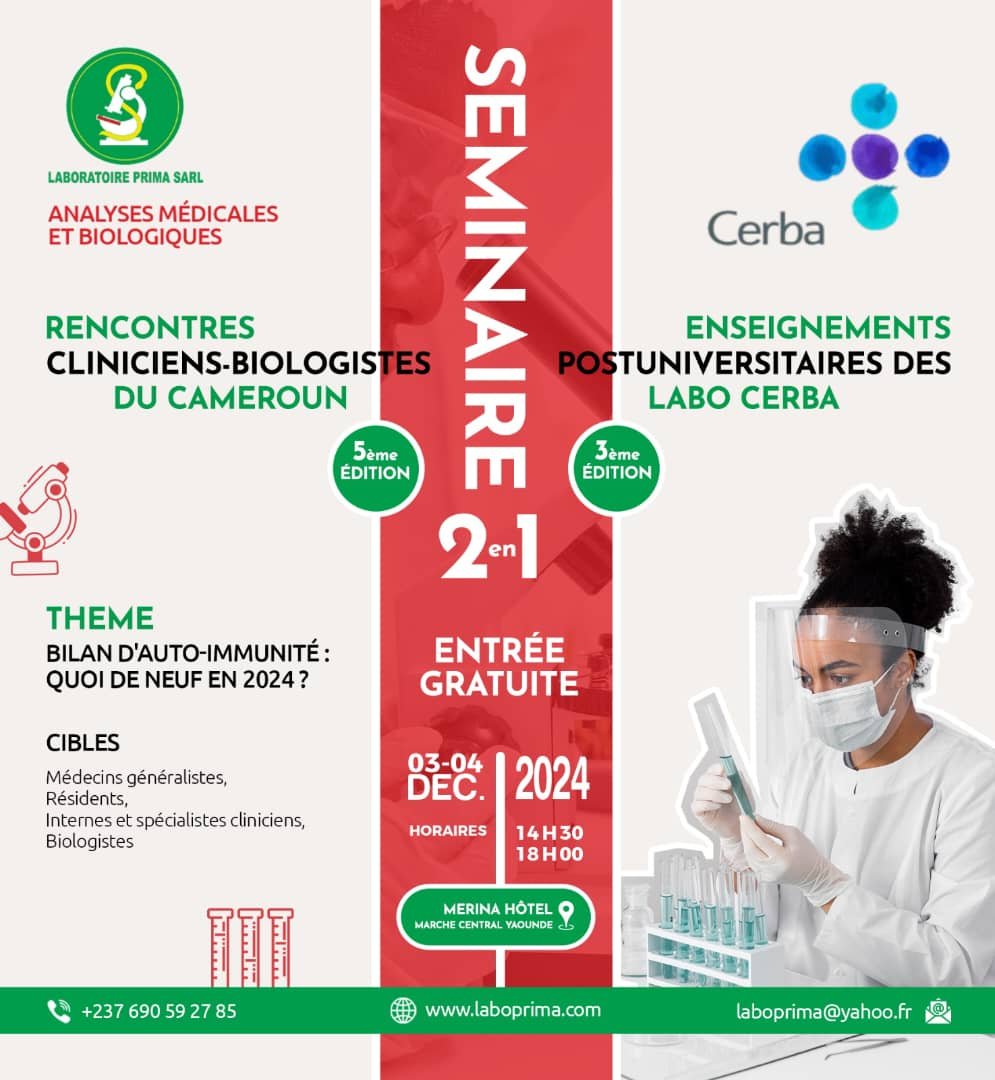











 Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.
Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.