Octobre Rose : vers une lutte inclusive au Cameroun !

Si le cancer du sein touche majoritairement les femmes, les hommes ne sont pas exclus, et le genre au-delà du sexe biologique joue un rôle crucial dans le parcours de soin.
Le principal obstacle est le diagnostic tardif : « Au Cameroun, plus de 80 % des patientes arrivent à l’hôpital à un stade avancé », déplore Dr Anne Sango, oncologue à Douala. Le coût élevé des traitements, la pénurie de spécialistes, et la faiblesse des infrastructures renforcent cette équation tragique.
Par ailleurs, à Yaoundé, le Centre de Sénologie de l’hôpital Marie Wyss offre des services de chirurgie mammaire, reconstruction et consultation multidisciplinaire. Lors de la campagne d’Octobre Rose 2024, 60 consultations et 7 interventions (dont 4 cas de cancer) ont été réalisées sur une courte période.
Des campagnes ciblant les femmes handicapées illustrent aussi l’effort d’inclusion : en novembre 2022, à Yaoundé, le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec l’Unfpa, a lancé une opération de sensibilisation et de dépistage dans ce public souvent oublié.
Mais malgré ces avancées, la dimension du genre reste trop peu abordée dans les discours publics et les politiques de santé.
Barrières psychologiques, sociales et culturelles
Chez les hommes, reconnaître un symptôme au sein est souvent confronté à la honte ou aux stéréotypes : « ce n’est pas un “cancer d’homme” » est une pensée répandue. Cela conduit fréquemment à des retards de diagnostic.
Chez les femmes, l’ablation partielle ou totale d’un sein est vécue comme une atteinte à la féminité, à l’estime de soi, dans une société où l’apparence compte.
Pour les personnes transgenres ou non binaires, le parcours de soin peut raviver des dysphories de genre, rendre l’accès aux examens (mammographie, consultation gynécologique) inconfortable ou stigmatisé, surtout si le personnel de santé n’est pas sensibilisé à la diversité des corps et des identités.
Inégalités dans l’accès aux soins
« Nous devons renforcer nos structures régionales de cancérologie afin que les gens n’aient plus à se déplacer vers Douala ou Yaoundé, perdant des mois dans l’attente. L’égalité d’accès au diagnostic et au traitement est une question de justice sociale. » Pr Louis Richard Njock, secrétaire général au ministère de la Santé publique, lors du 3ᵉ congrès de la Socasein.
Les populations les plus vulnérables — femmes en milieu rural, personnes pauvres, handicapées, celles vivant dans des zones périphériques — supportent le poids de l’exclusion. Le coût des traitements, le déplacement, l’absence de couverture santé font que certaines personnes, quel que soit leur genre, abandonnent toute idée de dépistage ou de suivi.
« L’égalité des sexes ne se limite pas à des quotas : elle doit s’étendre à la santé. Chaque femme doit pouvoir être dépistée, chaque homme informé qu’il n’est pas exclu, et chaque être humain reconnu dans sa singularité. », Dr Gertrude Moukouri Ngouchet, chef du service de gynécologie de l’hôpital Laquintinie (Douala), lors des campagnes de sensibilisation en entreprise.
Il s’agit de faire reculer les barrières invisibles, de redonner dignité à chaque corps, de garantir que ni le genre ni l’identité ne deviennent des freins à la vie.
Carole AMBASSA








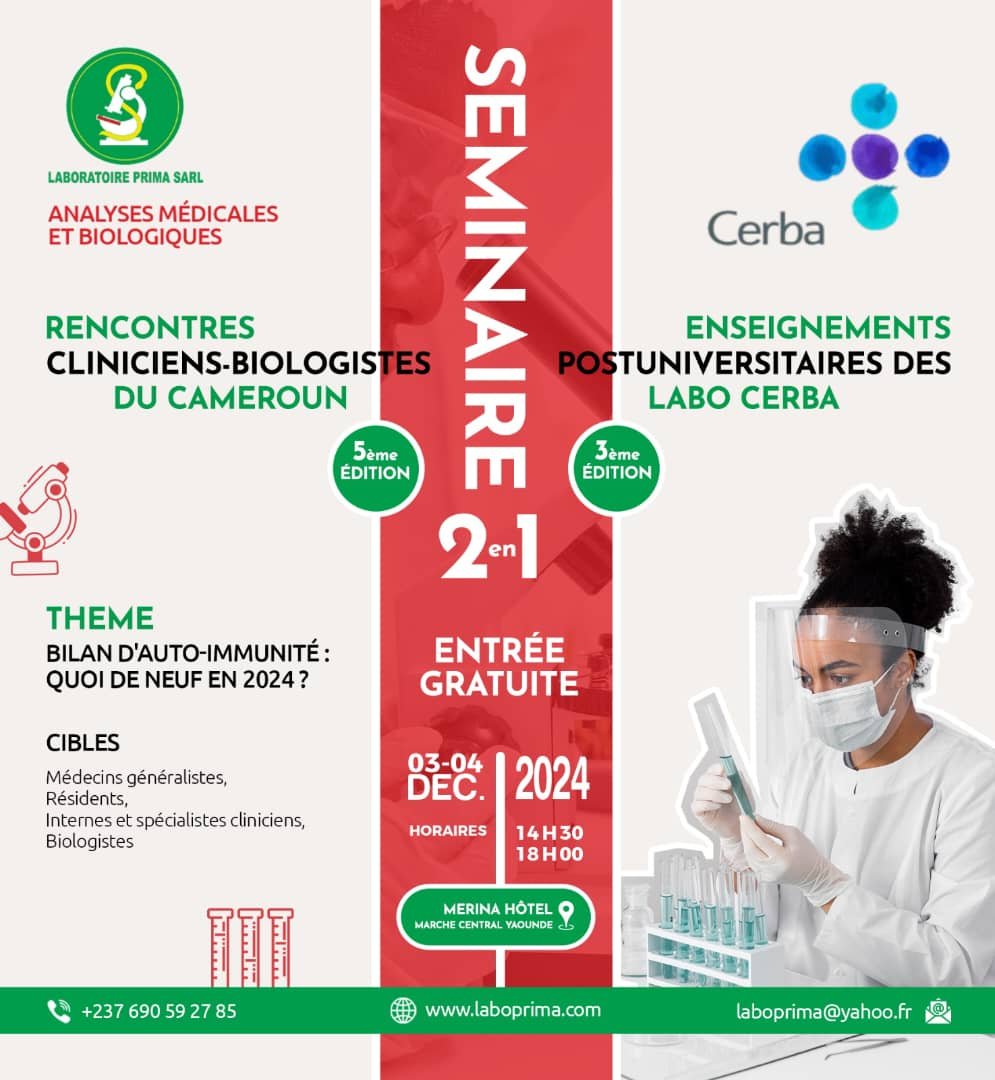











 Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.
Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.