Pêche artisanale au Cameroun : Un pilier vital en mal de reconnaissance

Au Cameroun, la pêche artisanale représente plus de 80 % de la production halieutique nationale, faisant vivre directement ou indirectement plus d’un million de personnes, principalement dans fluviales et lacustres. Malgré son rôle socio-économique fondamental, elle reste sous-équipée, peu valorisée, et confrontée à de nombreux défis structurels et environnementaux.
La pêche artisanale est pratiquée sur les côtes atlantiques (Littoral, Sud, Sud-Ouest), ainsi que dans les zones continentales comme les rivières Sanaga, Logone ou les lacs de retenue (Mbakaou, Lagdo, Maga). Elle se caractérise par des embarcations non motorisées ou à petits moteurs hors-bord, des techniques traditionnelles : filets maillants, lignes, nasses, sennes, une transmission intergénérationnelle des savoirs, une forte implication des femmes dans la transformation et la commercialisation du poisson.
Des contributions vitales mais peu reconnues
La pêche artisanale fournit une grande partie du poisson frais consommé localement, à un prix relativement abordable. Et elle génère des milliers d’emplois directs (pêcheurs) et indirects (mareyeuses, fumeurs, transporteurs, mécaniciens). Dan les zones rurales côtières ou fluviales, elle constitue parfois l’unique source de revenu.
Pourtant, cette pêche souffre d’un manque de reconnaissance institutionnelle, souvent reléguée derrière la pêche industrielle dans les décisions politiques et l’attribution des ressources.
Des défis qui freinent son développement
De nombreux pêcheurs artisanaux dénoncent l’empiètement des navires industriels dans les zones réservées à l’artisanat (moins de 3 miles nautiques du rivage). Ces intrusions provoquent la destruction des filets, la réduction des captures et parfois des accidents en mer.
Malheureusement, beaucoup de pêcheurs travaillent encore avec des pirogues en bois non motorisées et sans équipements de sécurité (gilets, balises). Et la vétusté des filets réduit la rentabilité et augmente les captures de juvéniles (non durables).
Le faible accès à la glace ou à des chambres froides dans les zones de débarquement garanti des pertes ; une perte post-capture importante, qui atteint parfois 30 à 40 % selon les zones.
La dégradation des écosystèmes côtiers (mangroves, estuaires) réduit et la pollution des eaux (déchets plastiques, hydrocarbures) constituent des obstacles conséquents à la productivité. Et les changements climatiques ne sont pas en reste. Ils modifient les cycles de reproduction des poissons.
Ce que demandent les pêcheurs artisanaux
Les pêcheurs artisanaux réclament la protection des zones côtières réservées à la pêche artisanale, avec un meilleur contrôle des navires industriels ; un soutien matériel : moteurs, filets conformes, glacières, équipements de sécurité ; la création de marchés de poisson modernisés, avec des chambres froides.
Sans un appui concret de l’État et des partenaires, la pêche artisanale risque de s’essouffler face à la concurrence industrielle, aux pressions environnementales et au manque de moyens. Si elle est correctement soutenue, elle peut devenir un modèle de développement durable à la fois social, économique et écologique.
Carole AMBASSA








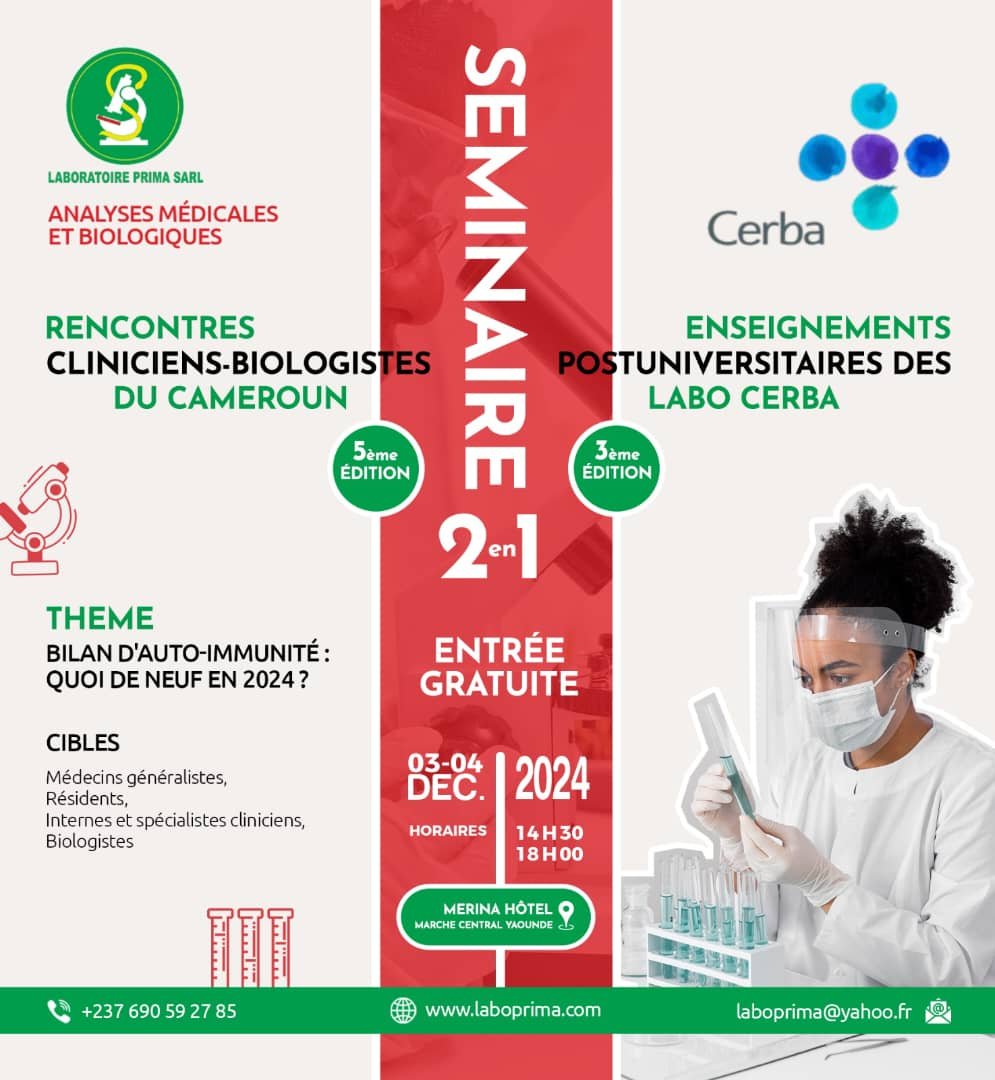











 Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.
Green And Health news a été crée afin de contribuer au developpement médiatique au Cameroun.